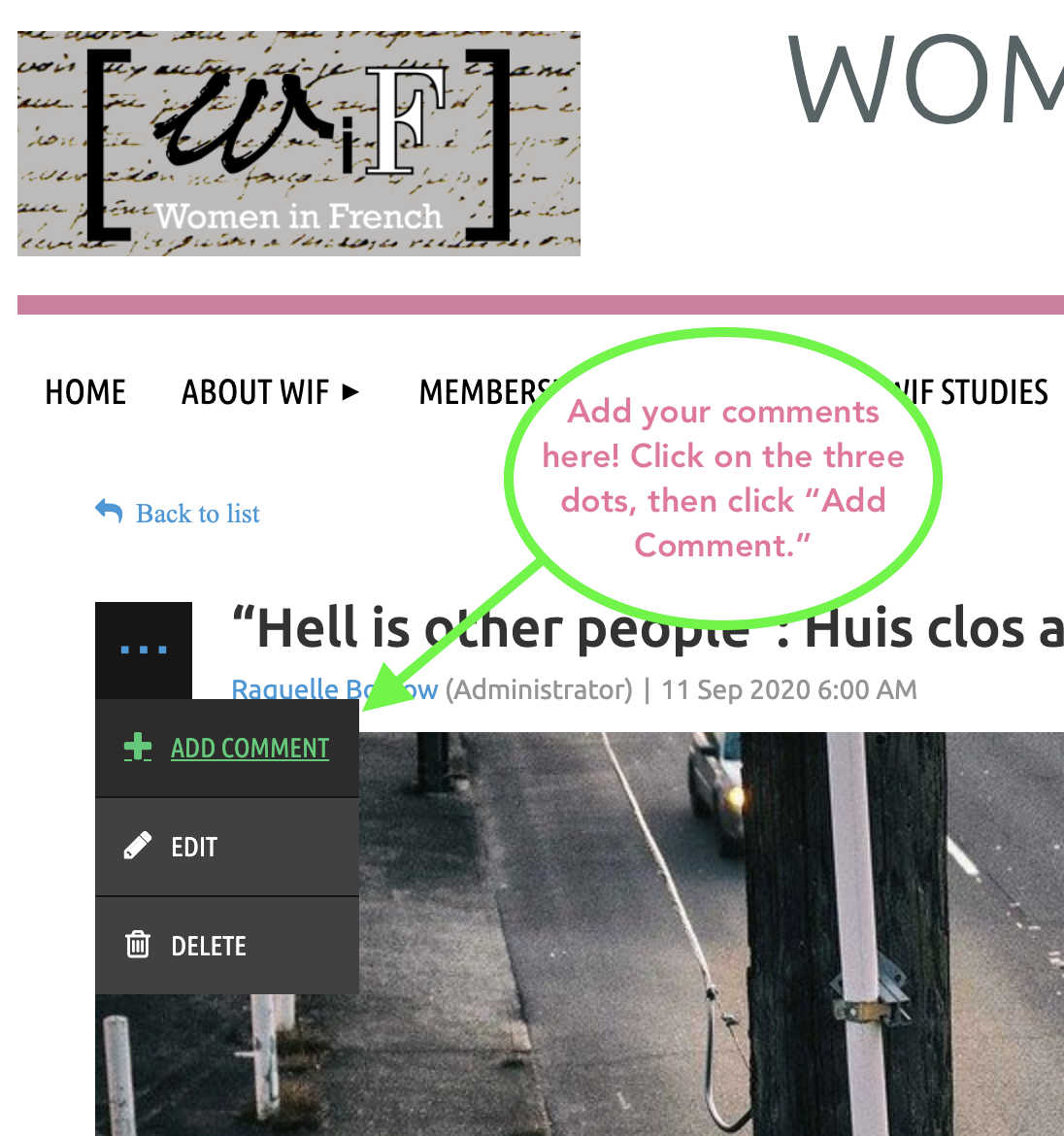24E COLLOQUE INTERNATIONAL GEORGE SAND ASSOCIATION « George Sand : Vivre, penser, écrire le temps »
Lyon, 22-24 mai 2024
Université Lyon 2 UMR 5317 IHRIM George Sand Association
Les propositions de communication, privilégiant les approches transversales plutôt que monographiques, sous la forme d’un résumé d’une vingtaine de lignes, accompagné d’une brève présentation personnelle, sont à adresser à olivier.bara@univ-lyon2, claire.barel- moisan@ens-lyon.fr et claudine.grossir@gmail.com avant le 1er octobre 2023.
Organisation : Olivier Bara, Claire Barel Moisan, Claudine Grossir
Comité scientifique : Pascale Auraix-Jonchière (Université Clermont Auvergne), Olivier Bara (Université Lyon 2), Claire Barel-Moisan (CNRS), Rachel Corkle (City University of New York)), Arline Cravens (Saint-Louis University), Brigitte Diaz (Université Caen Normandie), Claudine Grossir (Sorbonne Université), François Kerlouégan (Université Lyon 2), Pratima Prasad (University of Massachussetts, Boston), Damien Zanone (Université Paris Est Créteil).
Les récentes études historiques concernant la sensibilité au temps, conduites notamment par Alain Corbin, et mises en avant dans le champ de la littérature lors du dernier colloque de la Société des Études Romantiques et Dix-neuviémistes « Vivre vite. Le XIXe siècle face à l’accélération du temps et de l’histoire » (octobre 2021) ont contribué à définir la relation particulière que le XIXe siècle entretient avec le temps, fondée sur la constante tension entre les multiples temporalités qui coexistent au sein de la société, tant au niveau de la perception individuelle et collective du temps que de sa théorisation comme moteur historique. George Sand, en autrice d’une œuvre de son siècle et dans son siècle, jusqu’ici laissée à l’écart des approches historiques traditionnelles largement androcentrées, offre à ces études un vaste territoire de recherche. Traversant le siècle, elle en épouse le développement, participe à son essor artistique, intellectuel, politique, social, historique et expose à travers son expérience et son œuvre d’une grande diversité les multiples aspects du temps et leurs contradictions, propres à la modernité telle que la définit Christophe Charle. Leur étude, sous les angles anthropologique, sociocritique, historique ou poétique ne permettrait-elle pas d’éclairer les structures profondes de l’œuvre et d’en féconder la lecture ?
La perception du temps chez George Sand s’éprouve d’abord au quotidien : artiste, mais aussi cheffe de famille et propriétaire d’un domaine, elle cumule des responsabilités chronophages. « Noctiurge », à l’instar de Balzac, elle réserve les heures solitaires de la nuit à l’écriture. Mais cette partition du travail et des autres activités reste à évaluer et à interpréter : le travail de création ne déborde-t-il pas de l’écriture ? Quelle part les visites, les rencontres, les discussions, les lectures, les spectacles, les concerts prennent-ils dans l’emploi du temps, selon les saisons ou les lieux ? Comment nourrissent-ils le travail d’écriture ? Peut-on dessiner une histoire de cette sociabilité d’artiste ? De même peut- on construire une histoire intellectuelle qui prendrait en compte les études, voire les passions successives auxquelles se livre George Sand au fil de sa vie et de sa carrière (relevant des domaines de la politique, de la botanique, de la minéralogie, du théâtre par exemple) ? Quel portrait d’artiste en mouvement est-il possible de dresser à partir des données abondamment recensées dans la Correspondance et les Agendas ?
La gestion de l’œuvre et de la carrière, passant par les délais de livraison des publications en feuilleton, les corrections d’épreuves, les éditions successives, les contrats, les répétitions théâtrales, joue également avec le temps : l’œuvre prend sens au présent, s’ancre dans l’actualité, mais est aussi envisagée dans son devenir, sa pérennité, même d’une durée restreinte, si l’on en croit les propos adressés par Sand à Flaubert. Comme le corps humain, aux altérations duquel Sand est si sensible, l’œuvre peut-elle être considérée selon le modèle du temps biologique ?
Dépasser la fragmentation du quotidien et chercher la cohérence d’une existence singulière en l’inscrivant dans une trame temporelle plus large qui en explore les origines pour lui donner une direction et un devenir semble être l’une des fonctions du recours à l’autobiographie : Histoire de ma vie propose ainsi conjointement plusieurs voies d’accès à la saisie du temps. À la linéarité historique qui délimite un passé, un présent et un avenir pour en souligner la solidarité, voire la continuité, se superpose une approche poétique qui procède par cercles concentriques enserrant histoire personnelle, histoire familiale et Histoire relevant de temporalités bien distinctes. Quels principes de philosophie et de méthodologie de l’histoire guident ce récit comme les nombreux romans qui explorent le XVIIIe siècle, tels Consuelo, La Comtesse de Rudolstadt ou Nanon ? Plus que l’image de la Révolution, c’est le statut de l’événement et du cours du temps qu’il faudrait interroger, et confronter à celui mis en œuvre dans la pratique journalistique, notamment dans les textes politiques des années 1840. La dualité des temporalités, brèves et soudaines, ou longues et lentes, dont témoignent notamment les romans paysans qui retracent jusque dans leurs origines mythiques les us et coutumes d’un peuple et d’une région témoins de l’évolution lente des mentalités, est au cœur de la réflexion historique et politique de George Sand. Mais sa posture n’a peut-être pas toujours été la même pour accorder la primeur à l’une ou à l’autre, ou les conjuguer de manière signifiante, au fil des œuvres relevant de genres ou d’époques différents.
Ces questions ouvrent enfin un vaste champ encore inexploré d’études poétiques et linguistiques: le temps est ici un objet à la fois représenté et représentant. L’organisation des récits, des essais, des pièces de théâtre, le rythme adopté, le lexique et la syntaxe, autant d’indices d’une figuration du temps dont la visée est à la fois pragmatique et esthétique, et dont les effets sur le lecteur et le spectateur seraient à évaluer.
George Sand, affirme Michelle Perrot, avait « une conscience aiguë du temps sous toutes ses formes. » Ne serait-ce pas cette conscience passée à l’épreuve de l’art qui ferait entrer son œuvre dans la modernité ?
Pistes possibles (liste non exhaustive)
1. Le temps vécu
- Emploi du temps
- Jour/nuit, saisons
- Le temps qu’il fait
- Rythmes biologiques : jeunesse, maturité, vieillesse
- Temps vécu au masculin/au féminin
- Temporalités parisiennes/provinciales
- Temps et rythme du voyage
- Fêtes, cérémonies et autres rituels
- Perception du temps qui passe
- Lenteur et patience
2. Le temps de l’écriture
- Temps de travail/autres activités
- Périodisation du travail littéraire et journalistique
- Relectures, réécritures, corrections d’épreuves
- Publication en feuilleton, rééditions
- Composition théâtrale, répétitions, représentations, reprises
- Temps de la sociabilité littéraire
3. La pensée du temps
- Temporalités sociale, politique, historique
- Relation passé/présent/avenir
- Actualité et contemporanéité
- Histoire linéaire/cyclique
- Notion de progrès
- Événement/durée et très longue durée
- Recherche des origines, histoire mythique - Traces, archives
- Mutations, évolutions
4. L’écriture du temps
- Le discours sur le temps et ses modalités
- Écriture diariste (correspondance, journaux, agendas)
- Écriture de l’histoire et fiction ; temporalités du récit ; superpositions temporelles
- Mémoire(s) et souvenirs
- Rythmes narratifs et dramatiques : vitesse, accélérations et ralentissements, pauses, anticipations, retours en arrière, ellipses ; effets de réception (lecture et spectacle)
- Dire le temps : syntaxe, lexique
Bibliographie indicative
Bara, Olivier, Le Sanctuaire des illusions, George Sand et le théâtre, « Theatrum Mundi », Presses universitaires Paris-Sorbonne, 2010.
Bernard, Claudie, Le Passé recomposé, Le roman historique au XIXe siècle, Classiques Garnier, Paris, 2021 (1ère éd. 1996).
Bernard, Daniel, « Le regard ethnographique de George Sand », dans George Sand. Terroir et histoire, Noëlle Dauphin dir., Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 81-103.
Charle, Christophe, Discordance des temps, Une brève histoire de la modernité, EKHO, Dunod, Paris, 2022 (1ère éd. 2011).
Charlier, Marie-Astrid, Le Roman et les jours, Poétiques de la quotidienneté au XIXe siècle, Classiques Garnier, Paris, 2018.
Corbin, Alain, « L’arithmétique des jours au XIXe siècle », Le Temps, le désir et l’horreur, Essais sur le XIXe siècle, « Champs histoire », Flammarion, Paris, 2014 (1ère éd. 1985).
Corbin, Alain dir., La pluie, le soleil et le vent. Une histoire de la sensibilité au temps qu’il fait, Aubier, Paris, 2013.
Dequidt, Marie-Agnès, « Comment mesurer l’intériorisation du temps », Revue d’histoire du XIXe siècle n°45, 2012, p. 69-81.
Deruelle, Aude et Roulin, Jean-Marie dir., Les Romans de la révolution 1790-1912, A. Colin, Paris, 2014.
Desormeaux, Daniel, « Sand et le roman feuilleton : le cas des Beaux Messieurs de Bois- Doré », dans George Sand journaliste, Marie -Ève Thérenty dir., Presses universitaires de l’université de Saint-Étienne, 2011, p. 203-217.
Didier, Béatrice, « Nanon, roman de la Révolution », dans Histoire et temporalité, Aisthesis Verlag, Bielefeld, 2007, p. 131-138.
Didier, Béatrice, George Sand écrivain « Un grand fleuve d’Amérique », PUF, Paris, 1998.
Dumasy, Lise, « La publication en feuilleton d’une autobiographie : Histoire de ma vie de George Sand dans La Presse (de la scandaleuse à la sainte) », dans George Sand journaliste, Marie-Ève Thérenty dir., Presses universitaires de l’université de Saint-Étienne, 2011, p. 191-201.
Grossir, Claudine, « George Sand journaliste : l’invention de l’actualité », dans George Sand journaliste, Marie-Ève Thérenty dir., Presses universitaires de l’université de Saint- Étienne, 2011, p. 85-95.
Grossir, Claudine, «L’âge d’or de la vieillesse», dans Vieillir féminin et écriture autobiographique, Annette Keilhauer dir. Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont- Ferrand, 2007, p. 25-39.
Hoog Naginski, Isabelle, George Sand mythographe, « Cahier romantique n°13 », Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2007.
Perrot, Michelle, « George Sand et le temps », Les Amis de George Sand, Nouvelle série n°30, Tusson, 2004, p. 15-26.
Ricoeur, Paul, Temps et récit, « Points essais », Seuil, Paris, 3 tomes : 1983, 1984 et 1985. Rosa, Hartmut, Accélération. Une critique sociale du temps, La Découverte, Paris, 2010.
Saminadayar-Perrin Corinne (dir) et Bernard Claudie (dir), L’Histoire feuilletée. Dispositifs intertextuels dans la fiction historique du XIXe siècle, Presses Universitaires de Rennes, 2022.
Vierne, Simone, La femme qui écrivait la nuit, «Cahier romantique n°9», Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2004.
Zanone, Damien, Écrire son temps, Les Mémoires en France de 1815 à 1848, Presses Universitaires de Lyon, 2006.
Zonabend, Françoise, La Mémoire longue. Temps et histoire au village, Jean Michel Place, Paris, 1999.
Dossier « La mesure du temps », Romantisme 2016/4, n°174.
Les propositions de communication, privilégiant les approches transversales plutôt que monographiques, sous la forme d’un résumé d’une vingtaine de lignes, accompagné d’une brève présentation personnelle, sont à adresser à olivier.bara@univ-lyon2, claire.barel- moisan@ens-lyon.fr et claudine.grossir@gmail.com avant le 1er octobre 2023.